Antoinette BERGEVIN (Colette YVER)
Antoinette de Bergevin
dite Colette Yver
Femme de lettres
La vie d'Antoinette
Née en 1874 à Segré dans le Maine-et-Loire, Antoinette arrive peu de temps après sa naissance à Rouen. Son père Eugène de Bergevin né en 1822 à Fort-de-France est receveur de l’enregistrement. Il épouse Émilie Joséphine Aubry, née en 1835 à Marie-Galante. Parmi ses aïeux, on notera un arrière-grand-père, Pierre Marie Bergevin, guillotiné en 1794 à Brest et un autre, Joseph Vernier, quartier-maître au régiment de Guadeloupe, Chevalier de Saint Louis.
Antoinette commence à publier dès l’âge de 18 ans pour la Bibliothèque morale de la jeunesse. Ses romans, écrits sous le pseudonyme Colette Yver, parlent de la place des femmes dans la société. Pour Antoinette, la jeune fille doit être préparée à affronter la vie comme un jeune garçon et recevoir un enseignement identique pour prétendre aux mêmes carrières. Indulgente envers les femmes émancipées, Antoinette signe toutefois de nombreux romans antiféministes et se positionne contre le vote des femmes (cf. article plus bas). Les femmes doivent, selon elle, savoir abandonner une telle existence et devenir compagne et gardienne du foyer…
Elle reçoit le Prix Fémina pour « Princesses de science » en 1907 et entre au jury de ce prix en 1913. Elle en sera longtemps la doyenne, jusqu’en 1951. En 1917, elle fait son entrée à l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen. En 1931, elle est faite Chevalier de Légion d’honneur.
Antoinette épouse Auguste Huzard, traducteur, en 1903 à Rouen. Le couple n’a pas d’enfants et le mari meurt en 1911. Antoinette ne se remarie pas et porte dès lors un voile noir. L’écrivain a une sœur professeure de français et conteuse pour le Journal de Rouen (Marguerite) et un frère peintre (Édouard).
Une œuvre
Princesses de science
Critique dans Excelsior – 1913 (Retronews) :
« Dans Princesses de science. nous voyons sans étonnement des femmes qui renoncent à être princesses et qui abandonnent la science afin de se retrouver épouses et mères, ou simplement amoureuses, ou seulement femmes. Ce qui est très absorbant pour des personnes consciencieuses… Thérèse Herlinge est un grand professeur de je ne sais plus quoi, et elle a toutes les qualités qu’il faut pour être un grand professeur de je ne sais plus quoi. Elle est aimée de son mari, qui n’est pas bête du tout, fort savant aussi, mais brave homme. Elle l’aime bien, encore qu’elle lui préfère la science. Un jour son mari semble fuir une lutte inégale. Alors — et ce n’est pas uniquement par esprit de contradiction — sa femme lui revient. Elle met pour toujours la science au second plan, le mari au premier. Il était temps. »
J. Ernest-Charles
Dans la presse et au Jury Femina
Gil Blas, 13 septembre 1913
Retronews
Sa position contre le vote des femmes
La Française, 18 mai 1929
Bibliothèque Paris
Jury du prix Fémina 1927,
1ère à droite
Gallica
Antoinette dans les archives
Sources
- Archives : Filae, AD49, AD29, AD17
- Bibliothèques : Gallica, Retronews, Archive.org
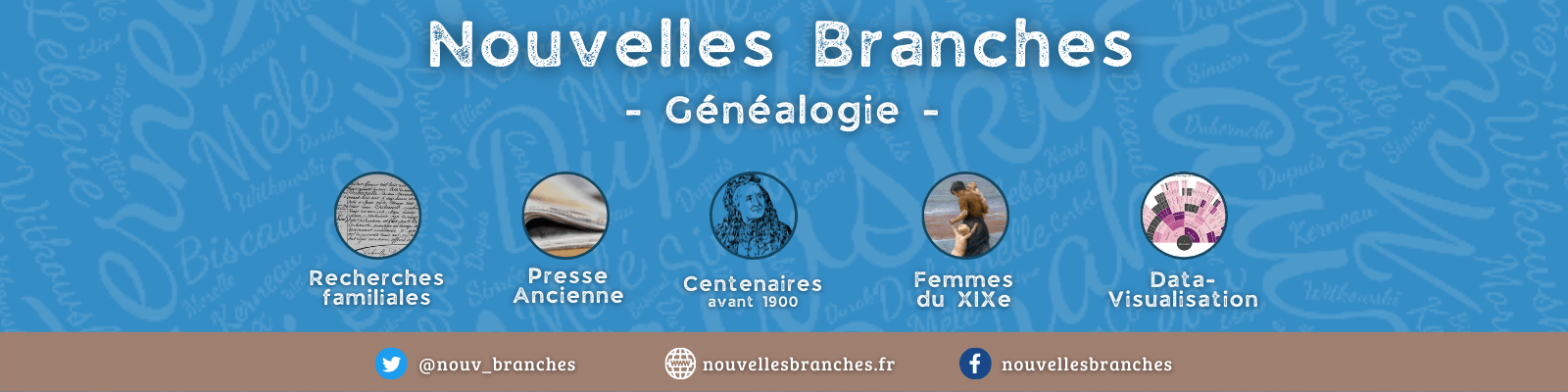








Bizarres, ces contradictions! Quant à la critique d’J. Ernest-Charles, elle est surprenante et finalement drôle, bien que son point de vue sur els femmes soit totalement inacceptable 🙂